
Une auberge pour les admirateurs de Jane Austen, et bien plus encore...
|
|
| | Les disparus de Daniel Mendelsohn |  |
| | | Auteur | Message |
|---|
Rosalind
Ice and Fire Wanderer

Nombre de messages : 17037
Age : 74
Localisation : entre Rohan et Ruatha ...
Date d'inscription : 17/04/2008
 |  Sujet: Les disparus de Daniel Mendelsohn Sujet: Les disparus de Daniel Mendelsohn  Sam 24 Sep 2011 - 2:26 Sam 24 Sep 2011 - 2:26 | |
| 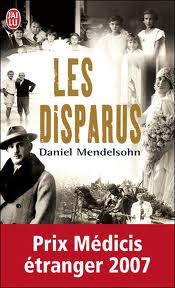 Daniel Mendelsohn Daniel Mendelsohn est un historien américain, spécialiste de la Grèce antique et critique au New York Time magazine. Il est né en 1960 à Long Island dans une famille juive. Tout a commencé quand il était enfant et s’étonnait de voir de vieilles personnes se mettre à pleurer en le voyant. C’est qu’il ressemblait étonnamment à son grand-oncle Shmiel, dont il savait seulement qu’il avait été tué par les nazis en 1941, ainsi que sa femme et ses quatre filles. Mais dans quelles circonstances exactement, et pourquoi était-il resté en Pologne alors que le reste de la famille avait émigré ? Son grand-père, pourtant prolixe en anecdotes de toute sorte sur la famille, reste étrangement muet. Le petit Daniel glane des bribes d’informations « je sais seulement qu’ils se cachaient dans un kessle » « quatre filles superbes » « il avait des camions, et les nazis avaient besoin de camions » et il commence à interroger ses oncles et tantes, et à collecter leurs souvenirs. A la mort de son grand-père il trouve dans son portefeuille des lettres de son frère Schmiel, des lettres bouleversantes qui le supplient de lui envoyer de l’argent afin qu’il puisse quitter la Pologne. Pourquoi son grand-père garde-t-il si précieusement ces lettres ? Avait-t-il essayé en vain d’aider son frère ? Ressentait-il la culpabilité de n’avoir pas pu le sauver ? Cela on ne le saura jamais. Mais cela incite le jeune Daniel à poursuivre ses recherches, qu’il affinera ensuite avec l’aide d’internet et des sites de généalogie. L’urgence le conduira à sillonner la planète afin de rassembler des témoignages de personnes ayant connu Schmiel et sa famille avant qu’il ne soit trop tard. Cette quête bouleversante est écrite à la fois comme une minutieuse enquête policière, et tissée selon un canevas antique à la manière d’Homère, normal pour un helléniste ! Le récit n’est pas plat et linéaire, mais enchevêtre le temps selon la technique du « récit en boucles ». Au cours de son enquête, il va comprendre que ce qui est important n’est pas seulement de connaître les circonstances exactes de leur mort, mais de savoir comment ils étaient, comment ils ont vécu. Et peu à peu ils prennent vie à ses yeux, et aux nôtres, et il va penser aux eux « comme à des gens ordinaires plutôt que de les considérer comme des icônes couleur sépia. » Shmiel très grand un peu sourd Les gens à Bolechow me prennent pour un homme riche sa femme Ester très chaleureuse, très sympathique une jolie paire de jambesses filles, Lorka l'aînée, orgueilleuse Frydka très belle, des yeux magnifiques, moderne, débrouillarde, séduisant les garçons- Spoiler:
l'un est même mort pour elle
Ruchele blonde avec des tresses, les yeux verts, placideet la petite dernière, Bronia encore très petite fille, toujours l'esprit à jouer D'autre part le livre est parsemé d’exégèses de moments majeurs de la Genèse dans la Torah que l’auteur met en relation avec son propre récit. Intéressant mais un peu ardu. En exergue il cite ce vers de l’Enéide : sunt lacrima rerum il y a des larmes dans les choses, et ajoute mais nous pleurons tous pour des raisons différentes.
Voici un entretien de Daniel Mendelsohn avec Philippe Coste (L'Express)- Spoiler:
«Comment des gens normaux deviennent des meurtriers»C'est l'un des chocs de cette rentrée littéraire! Après les chefs-d'oeuvre d'un Primo Levi ou d'un Raul Hilberg, décédé cet été, qui se flatterait d'ajouter un livre mémorable à ceux déjà écrits sur la Shoah? Sûrement pas Daniel Mendelsohn. Et pourtant... A 47 ans, ce spécialiste de littérature classique ne revendique ni la qualité de victime directe, ni d'historien, encore moins celle de juif américain exemplaire. Avec Les disparus, superbe ouvrage qui fit événement aux Etats-Unis lors de sa parution en 2006, il a ouvert une brèche dans les ténèbres de mort qui engloutirent, sous l'occupation nazie en Pologne, son grand-oncle Shmiel, sa femme et ses quatre filles. Si Daniel Mendelsohn touche au sublime, c'est pour avoir fait de cette enquête une formidable chambre d'écho. Franchise, hardiesse, décence: Les disparus sont aussi un formidable chant à la vie, à l'intelligence et à l'amour des frères humains. Honorer la mémoire sans exciter la trouble envie de voir, voilà le tour de force. Pourquoi et comment cet inconnu a-t-il écrit ce livre? Daniel Mendelsohn s'en explique auprès de Philippe Coste, notre correspondant à New York.
Les disparus sont l'un des livres les plus poignants, les plus humains, jamais publiés sur l'Holocauste. Est-il vrai que vous n'aviez pourtant jamais eu l'intention d'écrire un livre sur le sujet?
Daniel Mendelsohn. Je suis un spécialiste de lettres classiques et non un historien de l'Holocauste. Les disparus sont d'abord un livre sur ma famille, une sorte d'A la recherche du temps perdu, une tentative de retour aux fondations de mon histoire. Une histoire qui, effectivement, inclut l'Holocauste. Mon but était de combler un vide d'autant plus énorme qu'il est dû essentiellement à la Shoah. Mais la destruction des Juifs n'était pas mon sujet d'intérêt primordial. Je me suis engagé dans cette enquête longue de cinq ans, dans ces voyages, dans la recherche de dizaines de témoignages sur les six membres disparus de ma famille parce que, par réflexe professionnel, j'étais irrité par les pages manquantes de leur histoire personnelle. Au bout du compte, mon récit offre un prisme par lequel entrevoir plus largement l'Holocauste. Mais, de bout en bout, je suis resté centré sur eux.
C'est un livre sur l'identité?
D.M. Un livre sur la judaïté et, d'une certaine manière, sur votre continent, l'Europe. A un moment, je m'autorise une incidente sur la façon dont l'Europe a tenté, au cours des âges, de se débarrasser des Juifs. Quand j'ai écrit ce passage, je venais de relire, vingt-cinq ans après qu'un prof de mon lycée de Long Island me l'a fait découvrir, Le dernier des justes (prix Goncourt 1959). Comme le montre André Schwarz-Bart, on pourrait dessiner en creux l'histoire de la culture européenne à travers celle de l'oppression des Juifs. Et il se trouve que la culture européenne me passionne!
Vous faites état au début de votre recherche d'une grande distance par rapport au judaïsme.D.M. Il faut comprendre qu'aux Etats-Unis on peut être élevé avec peu de religion, mais beaucoup de judaïté. Mon père est un scientifique, un mathématicien salarié de Grumman (aujourd'hui Northrop Grumman), l'entreprise à qui la Nasa commanda le LEM qui servit à l'équipage d'Apollo 11 lors du débarquement sur la Lune en 1969. Il est totalement athée et montre peu de patience pour le surnaturel. Mais je l'ai entendu une fois réprimander mon frère Matt, qui était si rebelle dans les années 1970: «Tu te moques peut-être d'être juif, mais il se trouvera toujours quelqu'un pour te rappeler que tu l'es. Alors sois-en au moins fier!» Ma mère est très religieuse, comme son père, mon grand-père, qui était pour moi une figure du judaïsme, non seulement parce qu'il était très pieux, mais aussi parce qu'il représentait le passé européen des Juifs. Je me tenais à distance, mais j'étais en même temps un enfant curieux, observant tout, et dès mon plus jeune âge cet aïeul suscitait, lui et les vieux de la famille qui l'entouraient, mon profond intérêt.
Parce qu'il vous changeait de votre environnement quotidien?
D.M. Je vivais à Long Island, New York; la banlieue typique, au degré zéro de la culture. Un lieu où, dans les années 1960-1970, l'expérience culturelle se limitait à fréquenter le centre commercial. La ville où j'ai passé mon enfance n'existait pas un an avant ma naissance. C'était un champ de patates sur lequel, d'un seul coup, ont été plantées trois mille maisons identiques. D'où ce sentiment de superficialité, que je combattais en me rapprochant de mes aïeux juifs, en savourant leur richesse narrative, en plongeant dans une histoire qui remontait à plus d'un an... Ces vieux messieurs et ces vieilles dames représentaient une grande richesse, étrangère à mon environnement habituel. Ils débarquaient de Floride plusieurs fois par an. Ils parlaient sept langues, mangeaient une nourriture que je ne connaissais pas. C'est de cela que je voulais m'emparer. Mon lien avec eux était émotionnel, mais ils étaient surtout le point de départ de ma quête d'une culture authentique, d'une profondeur et d'une histoire. Le judaïsme, la judaïté plutôt, représentait pour moi une série de jalons moins religieux que culturels. A un journaliste israélien qui m'a demandé ce que j'avais ressenti en retrouvant ainsi mes racines juives j'ai répondu que je ne les avais jamais perdues. Je ne suis pas religieux. Mais j'ai toujours baigné dans cette culture.
Et l'étude des classiques?
D.M. Elle m'a apporté un avantage considérable. D'un côté, il y avait cette famille. De l'autre, à la faveur de ma fréquentation des classiques, un vif intérêt pour les racines les plus anciennes de la culture européenne. J'y ai gagné un double regard: une curiosité mêlée d'empathie pour les opprimés, mais aussi, d'une certaine manière, pour les oppresseurs et les bourreaux. Tout petit, je vouais une passion aux Romains, aux Egyptiens, quand bien même j'avais pu découvrir en écoutant le rabbin à la synagogue qu'ils étaient les méchants dans notre culture! J'ai toujours gardé cette vision stéréoscopique qui, je pense, m'a apporté plus de profondeur.
Etrange mélange tout de même...
D.M. Athènes et Jérusalem? Mon grand-père juif, par son extraordinaire talent de conteur, m'a d'abord donné le goût du récit. Ensuite, à l'école, comme tous les gamins, j'ai été conquis par les mythologies grecques, ce coeur fondateur de la culture occidentale. C'est un monde plein de sexe, d'intrigues, de monstres et de créatures étranges, de toutes les bêtises que peuvent faire les dieux!
D'où votre passion pour le récit?
D.M. Mon livre est consacré à la narration orale. Je suis frappé par la différence entre le narratif oral et écrit, et par la manière dont l'oral devient écrit. Mon sujet m'a conduit à jouer les historiographes amateurs, à m'interroger sur la façon dont l'histoire que vous lisez est devenue histoire. Et je passe mon temps, dans Les disparus, à rappeler au lecteur qu'il y a des problèmes terribles dans la façon dont une expérience personnelle devient un récit, dans la manière dont quelqu'un comme moi rassemble ces récits entendus dans un texte écrit. Des choses se perdent tout le temps. Le titre du livre n'évoque pas seulement les six membres «disparus» de ma famille, mais une quantité d'autres disparitions. Pas seulement des gens, mais des faits, des points de vue.
Y a-t-il eu un moment clé qui vous a décidé à entreprendre ce projet?
D.M. Plutôt une succession de moments, accumulés depuis l'enfance, et culminant à la crise de la quarantaine! Cet instant où l'on regarde autant vers le passé que vers l'avenir, où les membres de l'ancienne génération commencent à mourir, où ils perdent leur caractère immuable. Un de mes oncles, frère de mon père, est mort en mars 2001, ce qui m'a donné un sentiment d'urgence... L'Histoire elle-même m'a permis d'écrire ce livre. Sans Gorbatchev, rien de tout cela n'aurait été possible. Depuis mon adolescence, je contemplais la ville de Bolechow, berceau de ma famille, sur une carte de la république socialiste soviétique d'Ukraine. Je me disais: «Dommage! Tu ne pourras jamais y mettre les pieds...» Et puis le monde a changé. Il suffit de prendre un billet d'avion pour s'y rendre. Les informations sont disponibles, non seulement dans l'ex-Union soviétique, mais aussi sur Internet - il suffit de taper un nom sur des sites généalogiques comme JewishGen pour obtenir quantité d'informations que je compilais à la main depuis mon adolescence.
Un beau jour, en 2001, j'ai dit à mon frère aîné Andrew que j'aimerais aller à Bolechow. Cela paraissait fou. Tant de temps avait passé. Mon grand-père était mort depuis vingt ans; le lien avec le berceau de la famille était devenu si ténu. Comme souvent dans les récits d'immigrants comme mon grand-père, le vieux pays avait pris une allure si mythologique que Bolechow ressemblait à un lieu irréel. Un Shangri-La - ce havre de l'Himalaya imaginé par James Hilton dans Horizon perdu (1933) - juif. Mais Andrew m'a dit: «Je t'accompagnerais bien.» Ma soeur Jennifer a demandé à être du voyage, ainsi que mon frère cadet Matt, qui voulait se charger des photos. Cela a d'abord donné un article pour le New York Times Magazine puis, des années plus tard, ce livre.
Les disparus racontent l'histoire des Jäger, la famille de votre mère. Il n'y avait rien à dire du côté des Mendelsohn, votre famille paternelle?
D.M. De leur côté, il ne reste rien. Tout a disparu. Aucune information sur laquelle s'appuyer. Mes grands-parents paternels sont arrivés tout bébés aux Etats-Unis. Ils ont eu une existence purement américaine. A l'inverse, mon grand-père maternel était adulte à son arrivée d'Europe. Il avait une mémoire européenne qui constituait un pont vers l'ailleurs. Mon grand-père... J'en ai fait tout jeune mon modèle. Je le regardais s'habiller avec élégance. Je lui ai emprunté sa passion pour les langues étrangères, que j'ai apprises seul très jeune, par désir d'être le citoyen d'un monde plus large. Je l'écoutais passer d'une langue à l'autre, selon les sujets, dans les conversations avec ses innombrables cousins. C'était fascinant. J'ai su que j'avais un autre avenir que celui de devenir, que sais-je, orthodontiste dans un de ces pavillons de Long Island...
Enfant, votre ressemblance physique avec l'oncle Shmiel, le frère de votre grand-père, mort à Bolechow, était si frappante que des gens de votre famille fondaient en larmes en vous voyant entrer dans la pièce. Vous avez toujours souhaité savoir ce que recelait cette douleur?
D.M. J'ai toujours su que l'histoire de Shmiel, de sa femme et de ses quatre filles, tués par les nazis, était «hors limite». Et jusqu'à la mort de mon grand-père, en 1980, j'ai cru que seuls la peine, le deuil l'empêchaient d'en parler. Mais lorsque nous avons découvert dans ses affaires ces lettres où son frère le suppliait de lui procurer l'argent nécessaire à sa fuite d'Ukraine, nous avons compris qu'il souffrait aussi d'une profonde culpabilité. Une culpabilité spécifique: tous les Juifs vivant en Amérique pendant la guerre se sont sentis coupables de ne pas avoir pu en faire assez, ou plus, pour ceux qui étaient restés en Europe. Mais là, c'était autre chose. Les supplications de Shmiel, ses demandes d'argent, étaient si explicites et si bouleversantes que l'on ne pouvait que se demander ce que ses destinataires avaient pu lui répondre d'Amérique. Or nous ne le saurons jamais, car ces lettres, comme tous les biens de Shmiel, ont disparu avec lui à Bolechow. Comme j'ignorais tout de ce grand-oncle resté en Ukraine, et que je vénérais mon grand-père, j'ai pu en déduire que Shmiel était un membre mal-aimé de la famille, ou un perpétuel quémandeur. Qui sait? J'ai appris, grâce au contenu de certaines lettres, qu'il avait reçu de l'argent de sa famille américaine, mais la somme qu'il demandait, 5 000 dollars, était colossale pour l'époque, l'équivalent de deux ans de revenus de mon grand-père. Je sais aussi que ce dernier a été ravagé par la culpabilité. Sinon, pourquoi aurait-il porté toute sa vie - comme une pénitence -, sur lui, sur son coeur, dans un portefeuille, les lettres de Shmiel? Ce mystère, dû à l'absence de l'autre versant de la correspondance, offrait sa texture émotionnelle au récit. Il appelait à ouvrir d'autres portes, à suivre d'autres pistes. Shmiel, par exemple, écrit à son frère qu'il ne peut compter sur la famille de sa femme. Qu'il n'a aucune confiance en eux. Cela soulève des questions. Qui étaient ces gens-là? Et les autres?
Le voyage a aussi commencé sur place, dans votre famille proche.
D.M.Cette recherche visait aussi à renouer notre relation familiale. En comblant les vides du passé, on remplit ceux du présent. Voilà pourquoi j'insère le récit en filigrane de ma relation avec mon frère Matt. Il représentait, en raison de nos mauvais rapports dans le passé, un autre proche disparu que je cherchais à retrouver. En me lançant dans ce projet, j'ignorais ce que j'allais découvrir, mais je savais que ma démarche mettrait en scène ma fratrie, ma relation avec Matt comme avec mes trois autres frères et soeurs et ma famille tout entière.
Il y a tant de pistes parallèles, jusqu'à ces passages étonnants, cocasses sur la Bible. Comment en avez-vous eu l'idée?
D.M. Cette idée d'introduire la Torah m'est venue parce que j'avais précisément besoin d'éclairer ce mystère des relations fraternelles, de relier l'émotionnel à l'intellectuel. J'étais en train d'écrire la seconde partie du livre, qui décrit le premier voyage en Ukraine et la découverte des fameuses lettres de Shmiel. Je vénérais mon grand-père, mais je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il avait pu trahir son frère. Cette hypothèse me causait un malaise profond. En bon universitaire, j'ai donc recherché un texte qui remette ce désordre émotionnel en perspective, et j'ai trouvé, bien sûr, Abel et Caïn, cet épisode extraordinaire, puis les commentaires du rabbin Rachi. L'incidence de ces textes sur mon histoire était telle que j'ai décidé de tout mettre dans mon récit, pour donner au lecteur un outil qui lui permette d'appréhender les questions abstraites en jeu. Mais pourquoi s'arrêter là? J'ai lu le début de la Genèse et j'y ai vu une réflexion sur la notion de récit. Chaque texte cadrait parfaitement avec ma démarche. Un autre exemple. Lors de notre voyage en Australie, à Sydney, nous avons rencontré un groupe de survivants de Bolechow qui nous ont raconté tous les détails épouvantables de l'extermination des milliers de Juifs de la ville. A mon retour à New York, tandis que je transcrivais mes enregistrements d'interviews, j'ai pensé à Noé. Qu'est-ce que l'histoire de Noé, sinon le récit d'une annihilation presque totale; et de quelques survivants qui parcourent d'immenses distances pour reconstruire une civilisation?
Vous relevez aussi cette chose étonnante: une phrase de la Bible expliquant l'inimitié entre Abel et Caïn aurait disparu à cause d'une erreur du copiste?
D.M. Oui, il aura cligné des yeux et sauté une ligne. Nous ne saurons donc jamais, jamais, comme entre Shmiel et mon grand-père, ce qui se tramait réellement entre les deux frères. En tant que spécialiste des classiques, je suis habitué à travailler sur des fragments, à jouer de ces chaînons manquants. Mais là, il y a tout un symbole. Car mon livre traite avant tout de cette tragique ironie qui fait que des choses précieuses et fondamentales se perdent par accident. J'y tente, du début à la fin, de remplir ce passage à jamais manquant. Mais j'ai fait intervenir la Torah pour une autre raison. A mesure que je racontais notre enquête sur la mort de Shmiel et des siens, je me rendais compte que le livre prenait la tournure d'un polar trop haletant. Alors, par crainte éthique de rendre l'histoire triviale, j'ai jugé bon d'insérer ces passages sur la Bible - pour freiner le lecteur dans sa course, l'inviter à prendre du recul et de la hauteur, contempler un instant ces conflits humains, l'idée du Bien et du Mal.
Le mystère du Bien et du Mal?
D.M. Dans la Bible, Dieu détruit Sodome et Gomorrhe, sans que l'on sache pourquoi. On suppose qu'il s'y passe de vilaines choses, mais le Mal n'est jamais explicité. Le Bien non plus d'ailleurs, dans sa manifestation la plus absolue, quand Dieu sauve Isaac que son père s'apprête à sacrifier. Et ce double mystère imprègne Les disparus. Je reviens sans cesse sur la question insoluble. Pourquoi des gens, à Bolechow ou ailleurs, sauvent-ils leur prochain alors que d'autres font le mal et les massacrent sans pitié? Eux-mêmes n'en savent rien. J'ai en mémoire le documentaire sur ce village protestant, en France, qui avait caché des Juifs (Chambon-sur-Lignon). Une vieille dame, à qui on demande pourquoi elle a pris tant de risques pour des inconnus, répond, interloquée: «Mais comment aurions-nous pu ne pas le faire?» Elle n'a pas d'explication. L'explication s'est perdue dans l'indicible, comme la phrase manquante sur Abel et Caïn.
Le plus surprenant est la façon dont vous vous interdisez de juger...
D.M. J'ai pris le parti, dès le départ, de jouer les candides, de ne rien lire sur la destruction des Juifs d'Europe, de ne pas infliger mes a priori aux personnes que j'interrogerais. En feignant de ne rien savoir sur l'Holocauste, je pensais obtenir les réponses les plus authentiques possibles. Cela impliquait de refréner mes jugements, en particulier sur les Ukrainiens. Toute mon enfance, j'ai entendu dire: «Les Allemands sont mauvais, les Polonais plus encore, mais les Ukrainiens sont les pires.» Mais en tant qu'humaniste, je suis convaincu que tous les humains sont semblables, et que l'ignominie n'est en rien une caractéristique nationale. Aucun peuple n'est moralement inférieur à un autre. Si l'on exclut les salauds et les psychopathes, l'Holocauste amène à s'interroger sur le mécanisme qui conduit des gens normaux à devenir des meurtriers. Et j'en parle sans complaisance. Les Ukrainiens ont vécu leur propre holocauste - cinq millions sont morts de famine sous le joug de Staline avant l'arrivée des Allemands. Ils nourrissaient un ressentiment profond pour les Juifs, qui à leurs yeux, à tort, représentaient l'ancienne élite communiste. Voilà, notamment, ce qui les a rendus farouchement antisémites. Le Mal n'est pas l'apanage des méchants. Ce qui me frappe dans l'Holocauste, ce n'est pas, comme dans Les Bienveillantes, de Jonathan Littell, que des gens qui sont déjà des assassins-incestueux-homosexuels refoulés, affublés de tous les clichés de la décadence morale, se mettent à trucider des vieilles mamies juives. Mais que des voisins gentils et honnêtes qui vont à l'église et adorent les enfants décident, un beau jour, de le faire.
Comment vous sentiez-vous en Ukraine, à Bolechow?
D.M. Anxieux, plein d'appréhension. Mais c'est là que j'ai pu ressentir le bénéfice de notre démarche, qui excluait toute généralisation pour nous concentrer sur la recherche de nos six parents disparus. Durant toute notre enquête, les Ukrainiens se sont montrés cordiaux, sensibles, hospitaliers et généreux. Il faut dire que nous arrivions en 2001 et, bien que juifs, nous appartenions à une autre génération, à un autre pays, qui plus est les Etats-Unis. D'autres gens se sont vu claquer des portes au nez, comme un rescapé revenu sur les lieux en 1996.
Et Shmiel, qui était-il?
D.M. Il était l'aîné. A ce titre, son absence lui ayant donné sans doute une épaisseur romantique, il apparaissait comme une version glorifiée de mon grand-père. Il m'apparaissait aux confins du réel et de l'imaginaire. Avec plaisir, j'ai découvert au gré des souvenirs recueillis à quel point il était semblable à des membres de ma famille. Cette dégaine majestueuse... Autre point important: il avait, comme mon grand-père, émigré à New York dans les années 1920. Mais il était reparti pour l'Europe un an plus tard. Il avait suivi la trajectoire convenue de tous les Juifs d'Europe de l'Est; et ce destin ne lui avait pas plu. Moi qui, dans ma banlieue verte, rêvait d'un ailleurs, je n'avais pu que m'identifier à lui. Pourtant, je ne me suis pas appesanti sur l'ironie tragique de son retour vers l'Europe. Je persiste à dire qu'il a fait le bon choix pour sa vie, et j'évite de faire peser sur lui, sur son existence, l'ombre macabre de l'Holocauste à venir, qu'il ne pouvait prévoir. Mon but était, non de céder au sentimentalisme, mais de lui restituer sa spécificité, ses caractéristiques d'individu, sa vie de boucher et de businessman à Bolechow, de père de famille. Sa banalité personnelle et humaine. Même ses quatre filles, que tout le monde mythifiait dans ma famille, n'avaient sans doute rien d'extraordinaire. Frydka était sûrement un personnage mémorable mais les autres, comme Ruchele, dont j'ai rencontré le petit copain de l'époque, Jack, était une petite blonde sage que je n'aurais pas remarquée dans mon école. Je ne leur rendrais pas justice, si, comme l'exige notre culture américaine des talk-shows, j'en avais fait des victimes héroïques; héroïques parce que victimes. Il mérite, elles méritent, que je raconte simplement qui ils étaient.
Vous semblez perdre cette réserve lorsque vous racontez l'horrible fin de Ruchele, torturée avec des centaines d'autres Juifs de Bolechow avant leur exécution à Bolechow, en 1943...
D.M. Je ne suis pas romancier. Mon livre est un travail journalistique et académique. J'ai réprimé le recours à l'imagination, à cette culture du simulacre, du reenactment, c'est-à-dire du parc à thème stupide, qui bousille la perception de l'Histoire par les Américains. Je ne me suis permis qu'en deux occasions de recourir à une reconstruction, par suppositions, de ce qu'avaient pu être la fin de Ruchele, et celle de Shmiel. Je récuse la tendance, superficielle et répugnante, que nous avons, aux Etats-Unis, à enfermer l'indicible dans des récits nets et rassurants, à faire visiter des wagons plombés à des gens dans les musées, juste avant le sandwich au poulet de la cafétéria, et à leur laisser croire qu'ils ont fait le tour de la question. La vérité est que nous ne saurons jamais ce qui s'est exactement passé. Cette information a pour toujours disparu. Voilà pourquoi le livre s'appelle en anglais The Lost («ce qui est perdu») et non The Found («ce que nous avons trouvé»). Le lecteur ne s'en tire pas à peu de frais, comme le voudrait notre culture, qui exige une «clôture», une cicatrisation définitive. Pour ma part, je suis adepte de la tragédie grecque. La tragédie, c'est que des choses horribles arrivent. Et que l'on n'y coupe pas. En Californie - ce ne pouvait être que là-bas - lors d'une conférence, un brave gars à cheveux longs et sandalettes m'a demandé: «Comment pouvons-nous commencer à nous en remettre, à cicatriser tout cela.» Je lui suis tombé dessus: «Pourquoi voudriez-vous vous en remettre, vous sentir mieux? Il y a eu des millions de morts, et cela fait mal. Un point c'est tout!»
Vous marquez parfois une réticence devant votre sujet. C'est le cas en Australie, où vous prenez votre temps avant de rencontrer les survivants de Bolechow. Pourquoi?
D.M. Qui se précipite pour entendre des choses horribles? Mais c'est vrai: le livre porte sur le désir de savoir - un désir qui disparaît sitôt assouvi. J'ai relu avidement A la recherche du temps perdu avant d'écrire Les disparus. Proust joue du double sens, intellectuel et érotique, du mot connaître. Il redoute de «connaître» Albertine, ou Odette, car il sait que le désir sera perdu et voudra passer à autre chose. Dans mon premier livre, The Elusive Embrace (où j'use de la mythologie grecque comme j'use de la Bible dans Les disparus), je relève que la culture gay est fondée sur le désir et aborde peu la question de sa satisfaction. Dans Les disparus, je joue avec le désir de savoir du lecteur, de crainte que la quête et l'intérêt s'épuisent. Que voulez-vous savoir? Jusqu'où voulez-vous savoir? Et je répète souvent les mots «difficile» ou «impossible de savoir»! Je maintiens, même à la fin, une insatisfaction. Dans un chapitre, l'un des témoins de Bolechow, Shlomo Adler, me prie de couper le magnétophone pour me confier un secret sur la police juive en Ukraine. J'obtempère, et je laisse un blanc dans le livre. J'ai reçu un courrier désespéré d'un lecteur me demandant comment j'avais pu faire ça. Même réponse qu'au Californien: «Mais pourquoi devriez-vous savoir? Pourquoi mériteriez-vous de tout savoir?»
Quel impact cherchez-vous à obtenir sur vos lecteurs?
D.M. C'est un livre pour des gens de ma génération, des quarante-cinquante ans, une génération charnière qui sera la dernière à avoir pu être en contact avec des survivants de l'Holocauste. Mes enfants, j'y pense, n'en verront plus jamais. Et je reçois ces lettres, ces messages de lecteurs m'assurant que grâce à ce livre ils ont enfin eu le désir de se rapprocher de leur vieille tante rescapée. D'autres pleurent, comme cette femme, sur mon répondeur, me racontant que son père est mort il y a deux ans et que jamais elle ne saura l'histoire de sa famille. C'est maintenant l'instant ultime, la dernière chance. Voilà pourquoi c'est avant tout un livre sur l'oralité; sur le contact verbal avec des gens vrais, à l'opposé d'une recherche livresque. Car une fois que ces neurones sont morts, c'est fini. Vous ne remplacez pas une mémoire éteinte. D'où le sentiment d'urgence qui s'empare du lecteur au fil du livre. Vite, vite, avant qu'il ne soit trop tard!
Ne voyez-vous pas Bolechow comme un paradis perdu, le shtetl idyllique? C'était un trou!
D.M. Jack, l'un des survivants, m'a dit: «Nous étions les premiers multiculturalistes!» Il est vrai que des peuples différents, Juifs, Polonais, Ukrainiens, cohabitaient plutôt bien dans l'est de l'Europe. Le melting-pot américain, l'idée que des cultures distinctes puissent se réunir au nom d'une commune humanité, a justement conduit les Juifs européens à venir ici, aux Etats-Unis. Mais leurs villes d'origine, en Europe, étaient elles aussi de véritables melting-pots qui grosso modo fonctionnaient. On pourrait poser la même question pour la Bosnie. Pourquoi cela fonctionnait-il? Pourquoi cette cohabitation a-t-elle soudain tourné à l'horreur? Pour moi, qui étudie la belle littérature antique, j'ai tiré une grande leçon de ma recherche dans cet ancien microcosme de Pologne orientale où, en marge de l'Holocauste organisé, des gens ont pu, du jour au lendemain, massacrer leurs voisins juifs: j'ai découvert l'incroyable fragilité de la civilisation. J'ai compris qu'il suffisait de peu d'ingrédients, la faim, la terreur, pour la faire basculer en quelques jours dans le chaos et l'ignoble.
Vous avez aussi retrouvé une famille.
D.M. Ah! Les Jäger! Plus qu'un clan, un pays en lui-même. Peuplé d'immigrants à cheval sur deux continents. Un pays dont j'ai pu explorer la géographie et les régions inconnues. J'ai fait un voyage dans la civilisation de mon grand-père, avant qu'elle ne disparaisse à jamais, avec sa cuisine, ses rituels, sa mémoire, son langage. Il y aura d'autres sagas d'immigrants, coréens, latinos, etc. Mais celle-là a disparu. Elle ne reviendra plus.
|
|   | | cat47
Master of Thornfield

Nombre de messages : 24251
Age : 67
Localisation : Entre Salève et Léman
Date d'inscription : 28/01/2006
 |  Sujet: Re: Les disparus de Daniel Mendelsohn Sujet: Re: Les disparus de Daniel Mendelsohn  Sam 24 Sep 2011 - 12:50 Sam 24 Sep 2011 - 12:50 | |
| Merci pour l'ouverture du sujet, Rosalinde, tu confirmes mon envie de lire ce livre.  Je vais peut-être prendre la VF, par contre, les passages plus ardus passeront sûrement mieux ainsi. _________________  |
|   | | Rosalind
Ice and Fire Wanderer

Nombre de messages : 17037
Age : 74
Localisation : entre Rohan et Ruatha ...
Date d'inscription : 17/04/2008
 |  Sujet: Re: Les disparus de Daniel Mendelsohn Sujet: Re: Les disparus de Daniel Mendelsohn  Sam 24 Sep 2011 - 15:31 Sam 24 Sep 2011 - 15:31 | |
| Ce livre est si foisonnant qu'il est difficile de penser à tout dire, et je voudrais être plus éloquente pour vous donner envie de découvrir ce témoignage poignant sur les victimes de l'Holocauste.
Je me rends compte en revoyant mon post que ce doit être la première fois que j'écris sans mettre un seul smiley...
Certains passages sont extrêmement durs, les quelques pages qui relatent (ou plutôt imaginent, puisqu'il n'y a eu évidemment aucun témoin, et c'est bien ce qui a rendu cette quête si ardue) les derniers moments d'une des jeunes filles sont insoutenables. J'étais aussi oppressée qu'en voyant les images du documentaire de Frédéric Rossif "De Nüremberg à Nüremberg", j'ai failli lâchement abandonner le livre à ce moment.
Un autre passage m'a profondément choquée, lorsque Mme Begley, une vieille dame qui avait réussi à fuir avec son enfant. Après la guerre, elle avait pris contact avec quelqu'un qui vivait dans leur ancienne maison, et qui lui lui a dit qu'il avait récupéré une bonne partie de ses photos, et que si elle les voulait, elle devait envoyer de l'argent. Elle l'a donc fait pendant un certain temps, et a récupéré ainsi des images de son passé.
Mais tout n'est pas aussi dur, et ce qui est prodigieux c'est d'accompagner Daniel Mendelsohn dans sa quête de la vérité, de vivre ses rencontres avec des rescapés de la Shoah, et de partager avec lui le bonheur de la moindre bribe de souvenir exhumée de leur mémoire.
Savoureuses également les expressions en yiddish, et la transcription de l'accent juif des vieilles personnes.
Cat je pense que la VF est très bien, j'ai lu que la traduction de Pierre Guglielmina était excellente.
|
|   | | cat47
Master of Thornfield

Nombre de messages : 24251
Age : 67
Localisation : Entre Salève et Léman
Date d'inscription : 28/01/2006
 |  Sujet: Re: Les disparus de Daniel Mendelsohn Sujet: Re: Les disparus de Daniel Mendelsohn  Sam 24 Sep 2011 - 17:30 Sam 24 Sep 2011 - 17:30 | |
| J'imagine bien que ce ne doit pas être un livre facile à lire. D'ailleurs quand j'ai vu dans l'interview que Mendelsohn faisait référence au Dernier des justes, d'André Schwarz-Bart, qui est un des livres qui m'a le plus marquée, ça m'a encore plus incitée à lire Les Disparus, mais aussi rappelé que ce genre de livres est poignant et ne nous laisse jamais indemnes.  _________________  |
|   | | Contenu sponsorisé
 |  Sujet: Re: Les disparus de Daniel Mendelsohn Sujet: Re: Les disparus de Daniel Mendelsohn  | |
| |
|   | | | | Les disparus de Daniel Mendelsohn |  |
|
Sujets similaires |  |
|
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
| |
| |
| |
|




